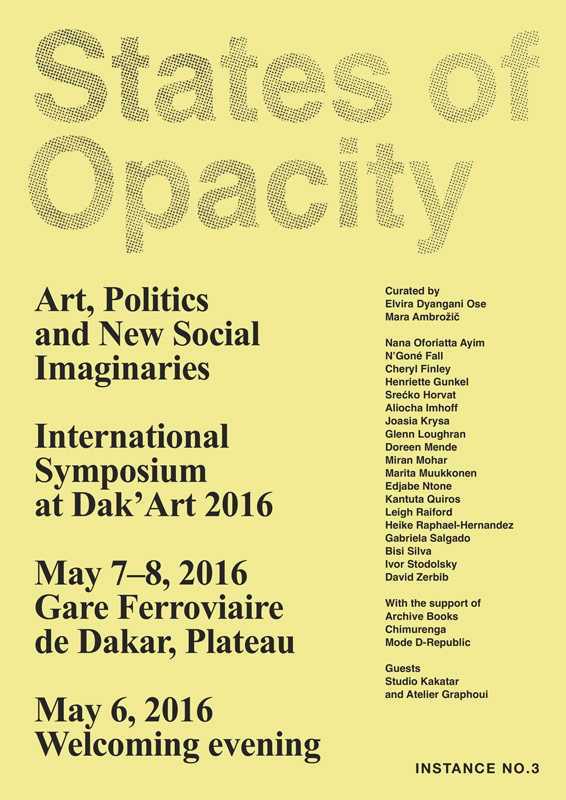Aliocha Imhoff & Kantuta Quiros
à l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, site de Quimper,
3 octobre 2013,
à l’invitation de Fabienne Dumont
10h – Herstory /auto-histoire : lire les autonarrations filmiques à partir des épistémologies féministes et postcoloniales
Avec ce que Michel Foucault identifiait en 1977 comme une « insurrection des savoirs assujettis » , les épistémologies, longtemps pensées comme subalternes et mineures dans la hiérarchie des connaissances – celles du délinquant, du psychiatrisé mais aussi des femmes et sujets postcoloniaux, longtemps objets des savoirs scientifiques et médicaux et de la représentation artistique, politique, etc.- ressurgissaient. En se réappropriant les dispositifs de production d’images et de discours, les subalternes inversaient les sites d’énonciation et de production de connaissances.
Plus particulièrement, l’autofilmage se faisait le lieu privilégié d’une fabrique auto-énonciative, subvertissant les dispositifs représentatifs. Nombre de cinéastes/vidéastes féministes et/ou issues de minorités postcoloniales repensaient les narrations filmiques, en produisant des historiographies collectives, en se mettant eux/elles-mêmes en scène, en abolissant l’opposition classique filmeur / filmé, auteur / sujet. Cette rupture épistémologique s’est nourrie d’outils théoriques proposés par les mouvements féministes de la seconde vague (herstory, consciousness raising, standpoint theory, etc.) puis par les artistes, théoriciens, écrivains, poètes des mouvements (post)féministes, queer et postcoloniaux des années 1980-90 (l’autohistoria-teoria et le nos/otras de Gloria Anzaldua, l’indignité de parler pour les autres de Craig Owens, l’autobiosociographie d’Annie Ernaux, l’autofiction d’Hervé Guibert, la constitution d’une « histoire des formes culturelles spécifiques au peuple noir » du collectif Sankofa Film & Video, etc.).
L’intervention propose une lecture croisée de ces outils théoriques forgés – notamment – dans le champ de la littérature, de la poésie et de la théorie critique, et d’œuvres s’inscrivant dans une histoire des autonarrations filmiques, issue du cinéma expérimental, de la vidéo et du film-essai (Yvonne Rainer, Carolee Schneeman, Katherina Thomadaki /Maria Klonaris, Nelson Sullivan, Hervé Guibert, Vincent Dieutre, Marlon Riggs, Isaac Julien & Sankofa Film & Video, Womanhouse, David Wojnarowicz, etc.).
Aliocha Imhoff & Kantuta Quiros
14h – Notes sur quelques fictions historiographiques. Présentation de l’exposition « Fais un effort pour te souvenir. Ou, à défaut, invente. »
Si l’investigation de l’histoire est devenue, ces dernières années, un motif récurrent autant dans les pratiques artistiques contemporaines que dans les récits curatoriaux, nous nous proposons d’y réfléchir ici, plus particulièrement, à partir des régimes de véridiction , mobilisés par l’histoire en tant que discipline de savoir. Alors que le partage entre science et fiction a été partie prenante des difficultés de la discipline historienne à rendre dicibles et lisibles les archives et les savoirs minoritaires, les voix et les présences des minorités en tant que sujets politiques dans la texture du passé, la fiction, telle qu’elle est mise en scène dans les historiographies produites par nombre d’artistes aujourd’hui, acquiert, à son tour, une valeur heuristique et politique, à même de reformuler une nouvelle écologie des savoirs historiques. A partir d’un retour sur l’exposition « Fais un effort pour te souvenir. Ou, à défaut, invente. » que nous présentions au centre d’art Bétonsalon ( janvier — avril 2013) et qui proposait une lecture historiographique, mobilisant les critiques postféministes et postcoloniales des catégories et des conditions de possibilité des savoirs scientifiques, nous envisagerons ici les puissances de la fiction à rendre compte de savoirs non textualisés et immatériels, qui excèdent les découpages disciplinaires et les formes normalisées du savoir et du récit historique linéaire.
Aliocha Imhoff & Kantuta Quiros